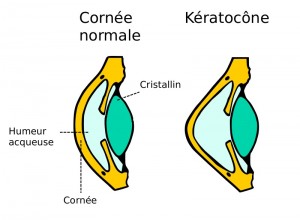Message d’amour (2)
Lire le début…
Samira la tira par le bas de sa robe, une fois, deux fois. Puis, elle alla vers sa mère et répéta le même geste. Le manège de sa sœur la fit sourire et elle ne fit plus durer son attente. Elle lâcha la courgette qui se balançait dans sa paume et qu’elle évidait habilement. Elle avait appris trop tôt à faire la cuisine et elle y prenait un grand plaisir qu’elle sacrifia volontiers pour les beaux yeux de la belle Samira.
Un sourire radieux éclaira le visage de la petite fille lorsque sa complice se leva, se lava hâtivement les mains et vint la rejoindre. L’enfant sautillait en traversant la porte de la cuisine. Pas celle qui menait vers le reste des pièces de la maison. L’autre, en fer, qui grinçait quand on la poussait et dévoilait un petit carré de vieilles dalles bordé de toutes parts de hauts murs sales et qui avait pour plafond un ciel lourd de nuages gris.
Elle saisit un balai et le passa autour d’elle, sous le regard enjoué de sa sœur. Elle ramena dans un coin tout ce qu’un reste de vieilles franges réussit à charrier sur cette surface rugueuse. Le tri se fit en quelques secondes : les mégots furent écartés, avec la poussière ; les cailloux attendirent qu’on décide de leur sort… Le jour où les trésors se faisaient rares, ils s’associaient, eux aussi, aux petits jeux de Samira. La tête d’une poupée, quelques perles, un mouchoir bariolé, des pages arrachées à un livre ou à un journal… tout était bon pour occuper l’enfant qui guettait chaque jour ces cadeaux du ciel.
La jeune fille leva la tête et tenta de deviner, un sourire amusé aux lèvres, de quelle fenêtre provenaient ses trouvailles, quelle main maladroite les avait laissé échapper … Bien souvent, une tête se penchait vers elle et revendiquait, à force de cris ou de larmes, un objet qui faisait pourtant briller d’envie les yeux de la petite. Cependant, l’objet en question était toujours restitué. Il n’était pas permis de s’approprier ce qui appartenait aux autres…
Elle ramassa les saletés, rangea le balai et laissa Samira découvrir le butin de cette matinée. Les cris joyeux de la petite fille, ses gloussements remplissaient l’air et parvenaient jusqu’à sa mère qui passait une bonne partie de la journée dans la cuisine, derrière ses fourneaux.
Les bonnes odeurs qui annonçaient que le repas était prêt rappelèrent à l’enfant qu’elle avait faim et la ramenèrent à l’intérieur. La grande sœur ne se fit pas prier ; elle remplit vite une grande assiette. Les courgettes flottaient dans un océan de yaourt dont la surface était recouverte d’une nappe de menthe sèche.
Deux chaises trouvèrent place sur le terrain de jeu de la petite Samira. Cette pause repas coïncidait, tous les jours ou presque, avec le rituel le plus sacré du voisinage. La sobhyé si chère aux femmes au foyer. Ce moment avait lieu soit, tôt le matin avant qu’elles ne vaquent à leurs occupations ménagères, soit, juste avant l’arrivée des hommes pour le repas de midi.
L’enfant affamée engloutissait avec appétit le contenu de la cuillère que lui tendait sa sœur aînée. Au-dessus d’elles, des têtes sortaient l’une après l’autre des fenêtres. Tantôt on se penchait tantôt on se tournait, le dos contre le bord de la fenêtre, la tête renversée en arrière, selon qu’on s’adressait à la voisine d’en bas ou celle d’en haut. Tout était permis : chuchoter, crier, rire aux éclats… On pouvait tout exprimer : sa fureur, sa joie ou ses malheurs. Tous les sujets étaient les bienvenus : la cuisine, les hommes… Les commérages, surtout, allaient bon train.
La jeune fille les écoutait avec amusement. Sa mère ne prenait jamais part à ces conversations. De temps à autre, elle écarquillait les yeux, soupirait ou souriait discrètement. Sans cela, on aurait cru qu’elle ne les écoutait même pas.
Au moment où la petite Samira s’approchait de l’assiette, la saisissant de ses deux mains et l’approchant de ses lèvres afin d’avaler une dernière gorgée de sauce, une rafale de tirs couvrit les voix des commères et les fit taire. Pas pour longtemps. Les têtes disparurent pendant quelques instants, le temps d’une deuxième rafale, puis d’une troisième. Puis, elles reparurent et les commentaires fusèrent : naissance, mariage, mise en liberté d’un détenu… Les avis divergeaient mais ils avaient en commun l’assurance qu’ «il ne fallait pas s’inquiéter », que c’étaient des « tirs de joie ».
Comment pouvait-on associer ces deux mots ? Comment ne pas s’inquiéter ? Comment rester insensible, impassible ?
A chaque fois que ces vilains tirs traversaient le ciel de la région, elle était en proie à une angoisse qu’elle ne réussissait pas à maîtriser.
L’assiette qui se fracassa à ses pieds la fit sursauter. Sa mère la tira à l’intérieur en maugréant, maudissant les mains qui étaient capables de tels actes. Elle n’oserait jamais prononcer de telles paroles en présence de son mari. Kaëd mehwar. Elle était la femme d’un chef, un vrai leader. Mais, elle n’en tirait aucune fierté.
La jeune fille ne l’entendait pas. Elle était sourde aussi aux sanglots de sa petite sœur. Sa tête était ailleurs. Elle ne pouvait qu’attendre. Il ne manquerait pas de se montrer ce soir. Il l’imaginerait bien rongée d’inquiétude, à le savoir dehors alors que la mort rôdait.
Les voisines pouvaient répéter ce qu’elles voulaient. Elles pouvaient se vanter de comprendre le message transporté par chaque balle. Il n’existait au monde qu’un seul message dont elle voudrait croire le contenu. Elle l’attendit. L’attente lui sembla durer une éternité.
♦♦♦♦
Des larmes chaudes coulaient sur ses joues et s’arrêtaient sur les coins de sa bouche. Leur goût salé ne l’écœurait pas. Au contraire, elle leur trouvait un goût délicieux. Ces larmes silencieuses qui lavaient les chagrins lui étaient plus chères que mille cris de joie qu’elle ne pouvait pas se permettre de lancer.
Elle s’essuya les yeux et le bout de papier qu’elle tenait entre ses doigts s’en trouva mouillé. Elle le déplia, le sécha en le frottant contre sa poitrine et y jeta encore un regard. Les lettres tremblaient ou était-ce sa main qui ne pouvait maîtriser son émotion.
Trois mots, rien que trois mots tracés maladroitement mais qui, pour elle, étaient plus éloquents que tous les discours du monde : « Ana mnih… bhebbek ». Que pouvait-elle souhaiter de plus ? Elle avait, sous les yeux, la preuve que Farid était en vie et qu’il l’aimait.
De ces preuves, elle possédait des dizaines qu’elle dissimulait astucieusement ici et là. Les dernières étaient toujours précieusement gardées à portée de main. Ces petits messages d’amour étaient lus et relus, consultés régulièrement à longueur de journée.
Ce n’était pas un simple courrier que le jeune homme lui glissait par la lucarne du grenier en lui frôlant les doigts ou qu’il laissait là, calé entre deux cailloux. C’était une partie de lui-même qu’il lui confiait.
Le message reçu était serré, caressé. Elle souriait au bout de papier et l’examinait longuement avant d’en déchiffrer le contenu. Certains détails en disaient long sur la journée de son bien-aimé. Elle savait qu’il venait de vider son paquet de cigarettes quand c’était dessus qu’il griffonnait ses mots tendres. Les je t’aime, tu me manques lui parvenaient aussi certaines fois noyés dans une poignée de jasmin aux pétales pétris qu’il avait dû cueillir tout en haut de l’escalier, en guettant le moment précis où il pouvait s’approcher de sa cachette. Elle pouvait aussi recevoir une figue ou une petite grappe de raisin à la nouvelle saison. Elle ne pensait même pas à les laver. Elle les glissait dans sa bouche, les faisait fondre sur sa langue et faisait durer aussi longtemps que possible ce plaisir indescriptible.
♦♦♦♦
Il n’était pas question de mettre le nez dehors ce matin. Depuis la nuit dernière, les tirs se faisaient plus fréquents. Et ce n’étaient pas des manifestations de joie. On entendait régulièrement des bruits d’explosions qui faisaient trembler les murs de la maison.
Le père et le frère étaient sortis en trombe, vers minuit, dès les premières rafales. On pouvait s’attendre à ne plus les revoir passer la porte avant quelques jours. Ce n’était pas la première fois qu’ils accouraient, armés, les traits dissimulés dans une cagoule, vers une destination inconnue. Ils ne pouvaient pas être loin. Ils se terraient sans doute dans le voisinage, sur un toit ou derrière un amas de sacs de sable. Ce blindage improvisé était censé les protéger des tirs des Kannass, l’autre camp ayant l’avantage d’habiter plus en hauteur.
Malgré ses six ans, Samira pressentait le danger. Mais, elle ne comprenait rien à ce sale jeu sans règles, que quiconque pouvait lancer et auquel tout le monde avait le droit de participer. Enfants et adultes pouvaient s’y mêler. Aucune compétence particulière n’était requise. Dans une partie du monde où chacun faisait ses propres lois, porter les armes était de mise.
La veille encore, le grand souk et ses alentours grouillaient de vie et de mille bruits. Un dédale dans lequel seul pouvait se repérer un habitant ou un habitué de la région. Ce jour-là, le spectacle était tout autre. Quelques chats osaient s’aventurer sous les tables en vieux bois solide qui recevaient quotidiennement fruits et légumes frais… Et les abadays musclés, une bande noire autour du front, une arme sur l’épaule… Et quelques enfants, mâles fils de mâles téméraires, habitués au sifflement des balles, à l’odeur du sang… Et… de loin, très loin, des soldats en uniforme, qui étaient là… pour la forme.
Peu à peu, la région fut plongée dans un silence de mort brisé de temps à un autre par les tirs des kannass. Les armes lourdes attendirent la tombée de la nuit pour commencer à cracher terreur et destruction sur ce coin de la grande ville…
La jeune fille ne bougea pas, assise à même le sol, adossée à un vieux fauteuil boiteux à cause d’un pied cassé que personne n’avait songé à recoller. Elle aimait le contact du tissu à fleurs, certes défraîchi, mais dont le motif lui communiquait, selon les occasions, un brin de joie ou une lueur d’espoir. Elle avait appris à apprivoiser son entourage. Elle avait réussi à se trouver, dans chaque coin, de quoi supporter la monotonie de sa vie. Et ce fauteuil dont sa mère avait hâte de se débarrasser faisait partie de ses alliés. Après chaque explosion, elle sursautait. Le vieux meuble l’accompagnait dans son geste, se posait à peine quelques secondes sur un pied devenu inutile depuis longtemps, puis revenait se poser sur son dos courbé, comme pour la protéger.
Elle n’eut pas faim de toute la journée et, la nuit, elle ne ferma pas les yeux. Samira, épuisée, avait fini par s’endormir sur ses genoux, bercée par les frissons qui secouaient tout son corps.
Le lever du jour s’accompagna d’un decrescendo des combats. Vampires, suceurs de sang, craignaient-ils de se brûler aux rayons du soleil ? Ou préféraient-ils garder dans le noir les preuves de leur inhumanité ?
Après l’appel à la prière lancé par les minarets des mosquées voisines, on n’entendit plus que quelques rafales. Les plus lointaines venaient d’ « en haut ». Celles, plus proches, dont la détonation vous déchire le cœur en même temps que les tympans, venaient « de chez nous », songea la jeune fille qui, ayant épuisé toutes ses larmes, fixait un point invisible sur le grand mur dont les fissures s’élargissaient un peu plus suite à chacun de « leurs » combats. Elle resta attentive à ces messages morbides qu’ils se renvoyaient comme une balle mais elle ne réussit pas à deviner qui avait eu le dernier mot…
Le passage assourdissant des chars de l’armée qui, finalement, s’était décidée à intervenir, s’accompagna du bruit de la porte d’entrée. Les deux abbadays de la maison firent une entrée pas plus victorieuse que les combats stériles qu’ils s’acharnaient à mener. Le père, blessé à l’épaule, les traits défigurés par la douleur et le manque de sommeil, avançait en traînant les pieds, soutenu par son fils qui n’avait pas meilleure mine.
Sans quitter son coin, la jeune fille déplaça son regard en direction de sa mère qui étouffa un cri d’effroi et faillit s’évanouir. Elle se précipita pour la soutenir et céda le passage aux deux combattants qui se jetèrent à même le sol dans le couloir qui menait aux chambres. Les sirènes des ambulances venues recueillir morts et blessés, comme on ramasse bouteilles et gobelets à la fin d’un match de foot, couvrirent le son de leurs voix.
Samira pleurait… Le père refusait d’aller se faire soigner. Ce n’était rien, juste une petite égratignure. Le frère maudissait les adversaires, l’Etat et… en secret, son père. Il ne comprenait pas ce cessez-le-feu trop précoce à son goût. Les snipers ne se plieraient sûrement pas aux ordres. Ils avaient doté leurs armes de silencieux. Ils allaient continuer à tirer en leur direction et le sang recommencerait à couler… Et Samira sanglotait de plus en plus fort… Le père ne se faisait aucun souci. Son camp était bien avance sur ce terrain-là. « Nos tirs ne les ratent presque jamais. Nous les atteignons jusque dans leur maison… » La jeune fille réprima un haut-le-cœur. Les propos du père la dégoûtaient. Et Samira hurlait…Sa mère l’entraîna dans la cuisine et enjoignit à sa fille aînée de la rejoindre.
La jeune fille la prit dans ses bras et couvrit son front de baisers. Son esprit bouillonnait. Elle voulait à tout prix jeter un coup d’œil vers l’extérieur, vérifier si une nouvelle lettre l’attendait. Quelques mots d’amour qui lui feraient oublier cette rude nuit… Elle parla à l’enfant d’un ton complice et lui proposa de l’accompagner dans un endroit « secret ». Samira se tut soudain. Elle crut à un jeu et son visage s’éclaira. Elle la suivit sans peine vers le grenier et, ainsi que sa sœur le lui avait expliqué, elle resta à l’entrée afin de guetter l’arrivée de quiconque viendrait les surprendre.
La jeune fille se précipita vers la lucarne, retira le morceau de tissu et aussitôt, un sifflement la fit sursauter. Elle s’éloigna de l’ouverture et se retourna… Les yeux écarquillés, la bouche béante, elle tomba sur ses genoux. Comment lire le message écrit à l’encre de la mort sur la poitrine ensanglantée de l’innocente Samira ?